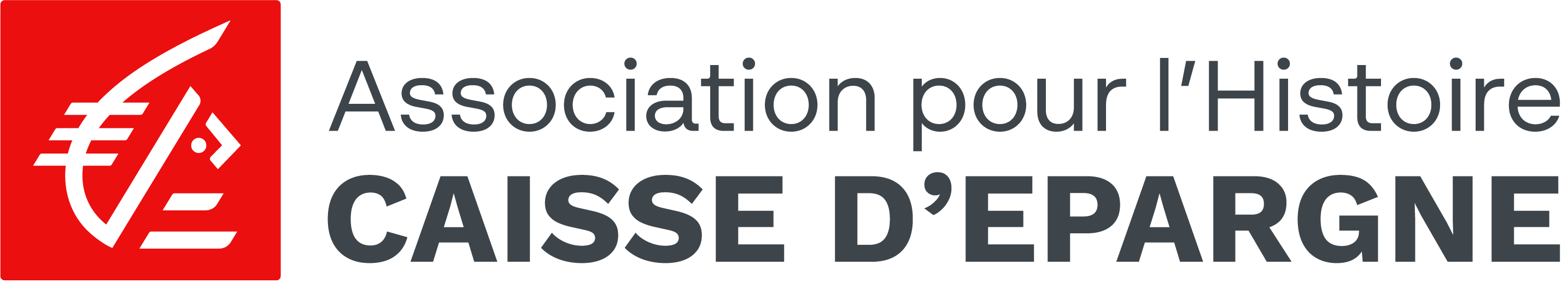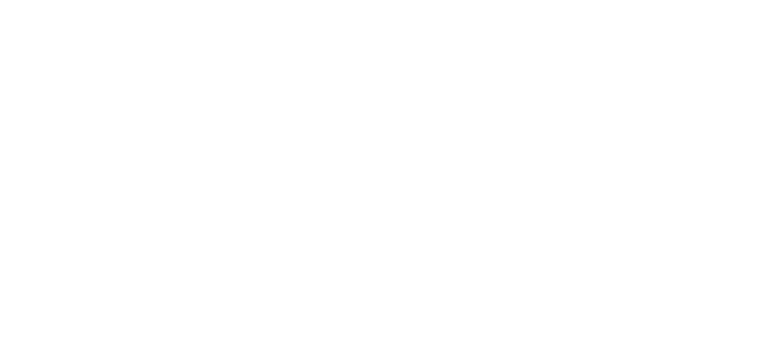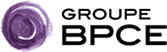C’est à la fin du XVIIIe siècle, en pleine expansion industrielle et commerciale, que patrons et marchands se rendent compte que le temps perdu représente une perte financière ; la tâche de l’ouvrier s’évalue à la seconde près.
Autrement dit : « le temps, c’est de l’argent », traduction de la boutade « time is money » popularisée par Benjamin Franklin dans « Conseils à un artisan » en 1748. « Souviens-toi que le temps, c’est de l’argent. Celui qui, pouvant gagner dix shillings par jour en travaillant se promène ou reste dans sa chambre à paresser la moitié du temps, bien que ses plaisirs, que sa paresse, ne lui coûtent pas six pence, celui-là ne doit pas se borner à compter cette seule dépense ; il a dépensé en outre, jeté plutôt cinq autres schillings. » Le temps se révèle comme une ressource précieuse à ne pas gaspiller. L’origine la plus ancienne de cette expression remonte au Ve siècle av JC. sous la plume d’Antiphon de Rhamnonte, rapporte Plutarque dans ses Vies : « Le temps, dont la dépense coûte plus cher que tout ».