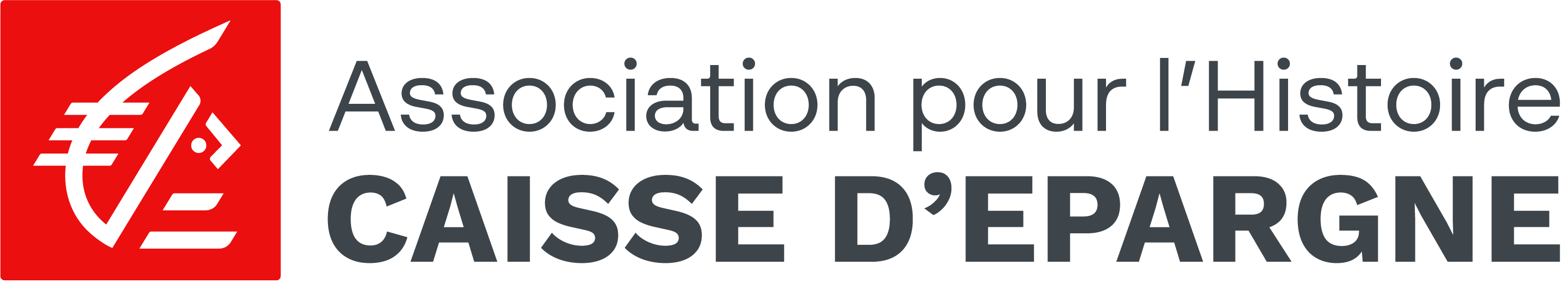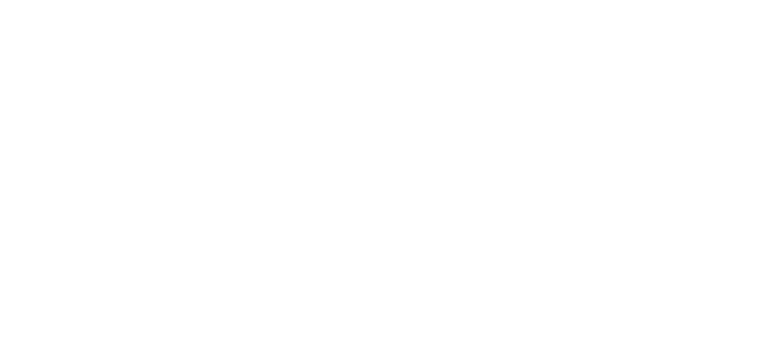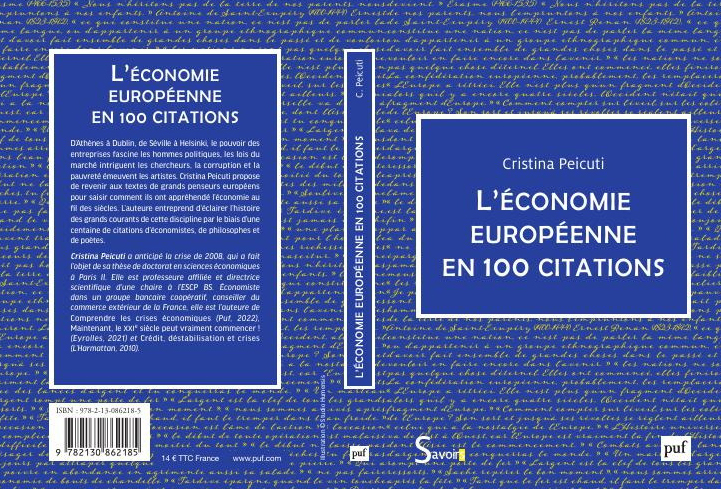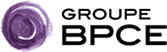Ce texte est extrait du livre « L’économie européenne en 100 citations » de Cristina Peicuti et met en avant la contribution des Caisses d’Epargne à l’égalité financière entre les femmes et les hommes.
Égalité financière femme-homme
En 1898, dans Les Lois relatives à l’épargne de la femme mariée. Leur importance pour la protection de l’épouse dans les classes laborieuses, Albert Aftalion, docteur en droit vivant en France, se préoccupe du problème de la condition de l’épouse, « l’un des plus douloureux, et de ceux qui exigent la plus prompte solution ».
Il attire l’attention sur la situation économique précaire de « l’épouse dans les classes populaires » et des enfants due à l’abus de la loi : « Publicistes et jurisconsultes s’accordent à déplorer la situation d’une femme soumise, sans protection efficace, aux pouvoirs étendus d’un mari, parfois indigne. Ses salaires, ses économies, indispensables pourtant à son entretien et à celui de ses enfants, sont légalement à la disposition du mari, seul juge de leur emploi, libre, s’il lui plaît, de les dissiper dans l’inconduite. De divers côtés on a cherché un remède contre les abus possibles de la part des maris. »
L’épargne des femmes
Dès 1881, les Caisses d’épargne créées en 1818 ont permis aux femmes de disposer de leur livret d’épargne sans l’aval de leur mari. Dans la préface de son livre Les Lois relatives à l’épargne de la femme mariée, Aftalion rend hommage aux caisses d’épargne qui sont allées plus loin que la loi ne l’exigeait dans son application : « Mais dans tous ces efforts faits pour améliorer le sort de l’épouse dans les classes populaires, on néglige injustement les tentatives déjà effectuées dans le même sens ; on oublie en particulier les lois récentes sur les Caisses d’Épargne, ou on n’en parle que dédaigneusement. Le secours qu’elles auraient apporté à la femme pauvre serait insignifiant ou illusoire. La faculté d’épargne qu’elles lui confèrent est une simple tolérance, que le mari est maître de faire cesser.
Il est vrai qu’à certains égards cette opinion est justifiée par le texte des lois sur les Caisses d’Épargne. »
Néanmoins, Aftalion fait remarquer que : « Mais les lois subissent souvent une transformation profonde, lorsqu’elles passent de la formule écrite à l’application concrète. Au contact des faits, les principes théoriques perdent leur netteté abstraite. Ils ne s’adaptent pas parfois à la réalité qu’en se dépouillant de leur rigueur ou de leur généralité primitives. Par suite des circonstances, sous l’empire de certaines nécessités, ou encore par leur combinaison avec d’autres principes juridiques, ils prennent un caractère tout différent de celui qu’on avait voulu leur attribuer, ils atteignent un but en vue duquel on ne les avait pas créés. Toute codification est impuissante à arrêter le développement secret et continu dans la législation d’un droit non écrit, d’un droit coutumier. »
Aftalion continue en rendant hommage aux caisses d’épargne qui vont plus loin que la loi pour établir l’égalité financière entre les femmes et les hommes : « Ces idées se vérifient précisément à propos des articles des lois sur les Caisses d’Épargne qui ont trait à l’épouse. Aussitôt après la promulgation de ces lois, des usages de fait, des « coutumes », pourrait-on dire, se sont établis qui ont donné au droit de la femme une extension à laquelle on n’avait pas songé. La liberté d’épargne, complètement indépendante de toute intervention maritale, que la loi avait refusée à l’épouse, la pratique n’est pas loin de la lui avoir accordée entière. La femme pauvre a été appelée ainsi à participer à côté du mari, dans les limites assez larges relativement aux ressources modestes du ménage, au gouvernement des intérêts pécuniaires de la famille. Et on peut apercevoir dans le contraste, en cette manière, entre les lois et la pratique, une expérience de législation qui n’est pas dépourvue d’enseignement. »
Aftalion conclut sur l’application de la loi par les caisses d’épargne : « En réalité, plus ou moins ouvertement, la pratique restreint, de manière sensible, les droits du mari, en faveur de l’épouse. Les prérogatives du mari demeurent intactes, tant qu’il n’a pas autorisé le premier versement de sa femme. Mais, dès qu’il l’a fait, il perd son pouvoir supérieur. L’épouse peut continuer à déposer malgré la volonté contraire du mari. Elle peut aussi empêcher tout remboursement des dépôts qu’elle trouverait inopportun. […] Une protection sérieuse était ainsi assurée à la femme dans les populations laborieuses. »
Le compte bancaire joint
Aftalion évoque aussi une autre mesure clé des caisses d’épargne en faveur de l’égalité femme-homme, alors qu’à l’époque la loi reconnaissait le mari comme maître de la communauté : « Mais une dérogation plus profonde encore est apportée aux règles du code. Les caisses doivent refuser tout remboursement à l’un des conjoints, au mari ou à la femme agissant isolément ; elles ne peuvent restituer les sommes déposées qu’aux deux époux ; si un seul d’entre eux se présente à la caisse, il doit apporter un consentement écrit de l’autre. Le mari maître pourtant de la communauté est ainsi incapable de toucher les créances communes ; il n’y parvient, contrairement aux principes, qu’avec le concours de l’épouse. »
Ouverture de compte
Aftalion explique que les caisses d’épargne auraient ouvert des comptes aux femmes mariées à leur nom de jeune fille pour leur permettre ainsi de jouir de la liberté de disposer de leur argent : « Il est vrai que, par un moyen un peu détourné, la femme parvenait en fait à déposer à la caisse, et à retirer, sans le concours de son mari. Elle se faisait ouvrir un compte à son nom de jeune fille et aucune restriction ne limitait alors sa liberté. Les administrateurs des caisses ignorant ou feignant d’ignorer sa qualité d’épouse ne s’inquiétaient pas des pouvoirs du mari sur les deniers qui leur avaient été confiés. »
Aftalion ajoute : « Il semble que dans les caisses d’épargne on montrait assez de complaisance à admettre la véracité d’affirmations semblables de la part d’une femme mariée. Une pratique presque générale s’était constituée en ce sens. On rappellera souvent cette pratique dans les débats qui devaient avoir lieu au Parlement au sujet des propositions de loi sur les caisses d’épargne. »
Aftalion poursuit en donnant des exemples : « La faculté de dépôt, sans autorisation préalable existe, dira-t-on, mais elle existe d’une manière irrégulière[1] » ou encore : « Quand elles (les femmes) déposent à la caisse d’épargne, on ne refuse pas leurs dépôts, et quand elles les retirent, on ne leur refuse pas davantage leurs retraits… Le livret donne le nom de la femme, mais il n’indique pas particulièrement le nom du mari[2]. »
Il écrit par rapport au dernier exemple : « On peut voir dans cette dernière phrase comme un aveu de procédé employé par les caisses, pour déroger en faveur de l’épouse aux principes fondamentaux du Code civil. Mais on doit reconnaître que de cette manière, quelles que fussent les circonstances du fait qui souvent excusaient les habitudes des caisses d’épargne, on sortait entièrement de la légalité. Il pouvait paraître désirable par suite que la législation intervînt pour consacrer et surtout pour compléter la protection que la pratique accordait à l’épouse. »
Le vœu du grand économiste et juriste Aftalion ne sera exaucé par la législation française que quatre-vingt-quatre ans plus tard avec la reconnaissance par la loi de l’indépendance financière des femmes en 1965.