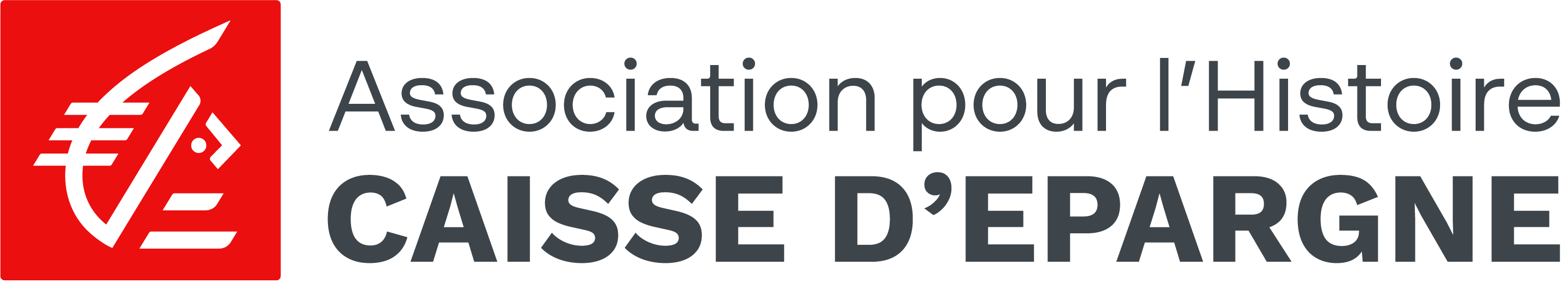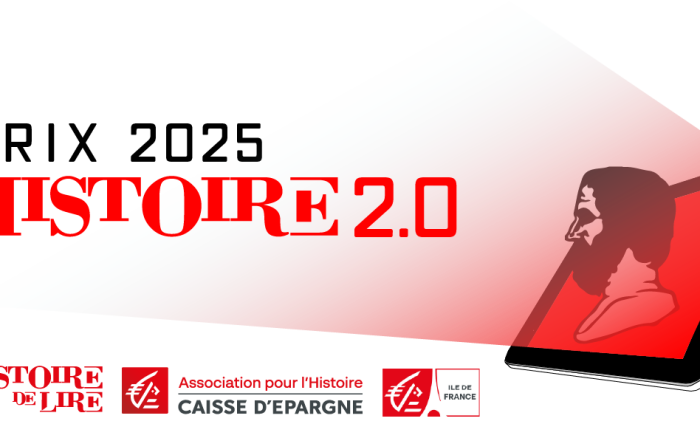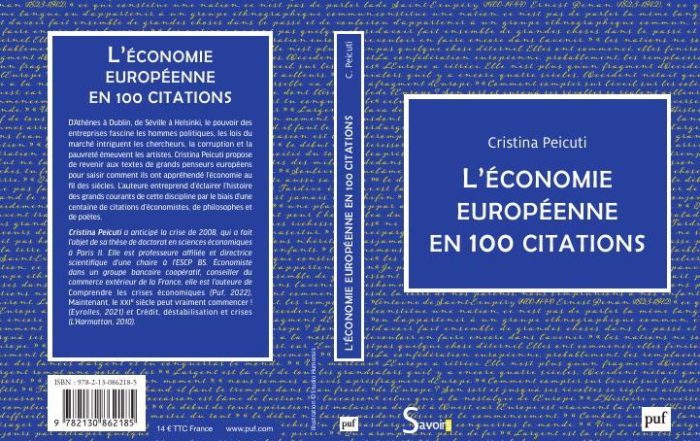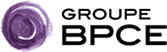À la une
Au carrefour d’hier et de demain
Retour vers le futur
Qu’elle soit portée par des académiques, des conteurs, des youtubeurs ou autres instagrammeurs, l’histoire est une source vivante et renouvelée d’inspiration. L’Association continuera, au travers de ses activités, de mettre en valeur ces différents passeurs d’histoire.
Inauguration, en octobre dernier, des Entretiens de La Rochefoucauld, qui se sont tenus au sein du château éponyme; participation en novembre, au prix Histoire 2.0, dans le cadre du festival Histoire de Lire de Versailles, pour récompenser les meilleurs créateurs de contenus; prises de parole, sur différents médias, pour faire vibrer l’esprit pionnier des Caisses d’Epargne : en 2025, l’Association a célébré l’histoire et ses acteurs sous toutes ces facettes !
Multiplicité de voix, mais aussi technologies nouvelles : l’essor de l’IA générative offre aux chercheurs et aux passeurs d’histoire des opportunités inédites.
Ces nouvelles technologies ne sont toutefois pas exemptes de danger.
Il appartient aux historiens, conteurs, et créateurs de contenu d’en employer tout le potentiel,en veillant à être les gardiens d’une histoire vivante, sincère et respectueuse des taits.
Alors que nous tournons la page vers 2026, souhaitons à chacun une nouvelle année riche en découvertes et en réflexions. Que demain soit une invitation à bâtir des ponts entre notre passé, notre présent et notre futur, éclairés par les leçons de cette histoire foisonnante. Bonne année à tous !
Newsletter
Inscrivez-vous à Pionnières, la lettre de
l’Association pour l’Histoire des Caisses d’Epargne
FAIRE RAYONNER L’HISTOIRE
DES CAISSES D’EPARGNE
Les Caisses d’Epargne font parties du club fermé des entreprises bicentenaires.
Elles possèdent une histoire qui s’incarne dans la vie des territoires et de leurs
habitants. Cette histoire éclaire un des marqueurs forts de leur identité, à savoir
leur rôle de pionnières dans les transitions de la société. L’Association pour l’histoire
a pour objet de mener toute action et étude permettant de faire pleinement
rayonner cette histoire et d’en promouvoir la richesse auprès des Caisses d’Epargne
et de ses clients, des institutionnels, du grand public.
À DÉCOUVRIR
Prix Histoire 2.0 & Salon Histoire de Lire 2025
L’Association pour l’Histoire des Caisses d’Epargne (AHCE) parraine le prix d’Histoire 2.0
Un partenariat pour une histoire vivante et accessible
Pour la deuxième année consécutive, l’Association pour l’Histoire des Caisses d’Epargne (AHCE) est partenaire du concours Histoire 2.0, organisé dans le cadre du salon Histoire de Lire à Versailles.
Ce concours valorise celles et ceux qui transmettent l’Histoire sous un angle moderne, créatif et accessible, à travers des formats numériques courts et longs.
Une manière innovante de rendre la mémoire collective vivante, en phase avec les valeurs de partage, d’éducation et de transmission que défend l’AHCE depuis plus de deux siècles.
L’AHCE est représentée au sein du jury par :
- Thomas Levet, Président de l’AHCE
- Laure de Llamby, Directrice de l’AHCE
Ils participent à la sélection et à l’évaluation des projets dans les deux catégories : Format Court et Format Long.
Le concours Histoire 2.0
Créé en 2022, le Prix Histoire 2.0 récompense chaque année des vidéastes qui explorent l’histoire à travers les plateformes numériques (YouTube, TikTok, Instagram…).
Deux catégories sont ouvertes :
- Prix du Format Court : pour les vidéos de moins de 5 minutes
- Prix du Format Long : pour les vidéos de plus de 5 minutes
Les participants 2025
Catégorie Prix du Format Long
- Yann Bouvier – L’origine probable du drapeau français : https://youtu.be/XcYuRaXuRe4
- Guilhem Jean – Les Gaulois savaient-ils écrire ?: https://youtu.be/UxDJtdZmufM
- L’Hydre aux mille têtes – Les influences de Zorro : https://youtu.be/xw2daO7SoEU
- Justine Defrance – La bête du Gévaudan : https://youtu.be/QezXCOaIMF0
- Tommy Tahir – Les fascismes : https://youtu.be/yeUmGMhW6O8
- Elsa Galinier – L’invention des vêtements : https://youtu.be/TUQLI7a4H7g
Catégorie Prix du Format Court :
- Métalleux Curieux – Nanowar of Steel : metal, vikings, gospel et Ikéa : https://www.instagram.com/reel/DOsdJz2jgWW/
- Soizichda – Le premier film d’animation japonais: https://www.instagram.com/p/DJrdlU6ocfp/
- Histoire à la carte – Saartjie, la Vénus Hottentote : https://www.youtube.com/shorts/sMAb6JjmzUE
- Culture et botanique – Balzac VS le mariage au XIXe siècle : https://www.tiktok.com/@cultureetbotanique/video/7481556573173615894
- Les Oubliées Podcast – Tradwife : les origines : https://www.instagram.com/reel/DMesAR1NtEN/
- Alphonsine Vintage – Les véritables Stormtroopers : des tranchées à Star Wars : https://youtube.com/shorts/wbgqh1ms67c
Félicitations aux gagnantes 2025
Prix Format Long
🥇 Elsa Galinier de la chaîne @passeport.pour.hier – L’invention des vêtements
Prix Format Court
🥇 Estelle Chantôme de la chaîne @alphonsinevintage – Les véritables Stormtroopers : des tranchées à Star Wars
L’engagement de l’AHCE
En soutenant le Prix Histoire 2.0, l’Association pour l’Histoire des Caisses d’Epargne :
- promeut une histoire partagée, inclusive et accessible à tous ;
- valorise les nouvelles formes de narration historique ;
- encourage la création numérique comme vecteur de mémoire ;
- soutient la jeunesse et la créativité dans la médiation culturelle.
Parce que l’histoire se vit aussi au présent, l’AHCE est fière de participer à cette aventure où patrimoine et innovation se rencontrent.
En savoir plus : Site officiel du concours Histoire 2.0
L’économie européenne en 100 citations
Ce texte est extrait du livre « L’économie européenne en 100 citations » de Cristina Peicuti et met en avant la contribution des Caisses d’Epargne à l’égalité financière entre les femmes et les hommes.
Égalité financière femme-homme
En 1898, dans Les Lois relatives à l’épargne de la femme mariée. Leur importance pour la protection de l’épouse dans les classes laborieuses, Albert Aftalion, docteur en droit vivant en France, se préoccupe du problème de la condition de l’épouse, « l’un des plus douloureux, et de ceux qui exigent la plus prompte solution ».
Il attire l’attention sur la situation économique précaire de « l’épouse dans les classes populaires » et des enfants due à l’abus de la loi : « Publicistes et jurisconsultes s’accordent à déplorer la situation d’une femme soumise, sans protection efficace, aux pouvoirs étendus d’un mari, parfois indigne. Ses salaires, ses économies, indispensables pourtant à son entretien et à celui de ses enfants, sont légalement à la disposition du mari, seul juge de leur emploi, libre, s’il lui plaît, de les dissiper dans l’inconduite. De divers côtés on a cherché un remède contre les abus possibles de la part des maris. »
L’épargne des femmes
Dès 1881, les Caisses d’épargne créées en 1818 ont permis aux femmes de disposer de leur livret d’épargne sans l’aval de leur mari. Dans la préface de son livre Les Lois relatives à l’épargne de la femme mariée, Aftalion rend hommage aux caisses d’épargne qui sont allées plus loin que la loi ne l’exigeait dans son application : « Mais dans tous ces efforts faits pour améliorer le sort de l’épouse dans les classes populaires, on néglige injustement les tentatives déjà effectuées dans le même sens ; on oublie en particulier les lois récentes sur les Caisses d’Épargne, ou on n’en parle que dédaigneusement. Le secours qu’elles auraient apporté à la femme pauvre serait insignifiant ou illusoire. La faculté d’épargne qu’elles lui confèrent est une simple tolérance, que le mari est maître de faire cesser.
Il est vrai qu’à certains égards cette opinion est justifiée par le texte des lois sur les Caisses d’Épargne. »
Néanmoins, Aftalion fait remarquer que : « Mais les lois subissent souvent une transformation profonde, lorsqu’elles passent de la formule écrite à l’application concrète. Au contact des faits, les principes théoriques perdent leur netteté abstraite. Ils ne s’adaptent pas parfois à la réalité qu’en se dépouillant de leur rigueur ou de leur généralité primitives. Par suite des circonstances, sous l’empire de certaines nécessités, ou encore par leur combinaison avec d’autres principes juridiques, ils prennent un caractère tout différent de celui qu’on avait voulu leur attribuer, ils atteignent un but en vue duquel on ne les avait pas créés. Toute codification est impuissante à arrêter le développement secret et continu dans la législation d’un droit non écrit, d’un droit coutumier. »
Aftalion continue en rendant hommage aux caisses d’épargne qui vont plus loin que la loi pour établir l’égalité financière entre les femmes et les hommes : « Ces idées se vérifient précisément à propos des articles des lois sur les Caisses d’Épargne qui ont trait à l’épouse. Aussitôt après la promulgation de ces lois, des usages de fait, des « coutumes », pourrait-on dire, se sont établis qui ont donné au droit de la femme une extension à laquelle on n’avait pas songé. La liberté d’épargne, complètement indépendante de toute intervention maritale, que la loi avait refusée à l’épouse, la pratique n’est pas loin de la lui avoir accordée entière. La femme pauvre a été appelée ainsi à participer à côté du mari, dans les limites assez larges relativement aux ressources modestes du ménage, au gouvernement des intérêts pécuniaires de la famille. Et on peut apercevoir dans le contraste, en cette manière, entre les lois et la pratique, une expérience de législation qui n’est pas dépourvue d’enseignement. »
Aftalion conclut sur l’application de la loi par les caisses d’épargne : « En réalité, plus ou moins ouvertement, la pratique restreint, de manière sensible, les droits du mari, en faveur de l’épouse. Les prérogatives du mari demeurent intactes, tant qu’il n’a pas autorisé le premier versement de sa femme. Mais, dès qu’il l’a fait, il perd son pouvoir supérieur. L’épouse peut continuer à déposer malgré la volonté contraire du mari. Elle peut aussi empêcher tout remboursement des dépôts qu’elle trouverait inopportun. […] Une protection sérieuse était ainsi assurée à la femme dans les populations laborieuses. »
Le compte bancaire joint
Aftalion évoque aussi une autre mesure clé des caisses d’épargne en faveur de l’égalité femme-homme, alors qu’à l’époque la loi reconnaissait le mari comme maître de la communauté : « Mais une dérogation plus profonde encore est apportée aux règles du code. Les caisses doivent refuser tout remboursement à l’un des conjoints, au mari ou à la femme agissant isolément ; elles ne peuvent restituer les sommes déposées qu’aux deux époux ; si un seul d’entre eux se présente à la caisse, il doit apporter un consentement écrit de l’autre. Le mari maître pourtant de la communauté est ainsi incapable de toucher les créances communes ; il n’y parvient, contrairement aux principes, qu’avec le concours de l’épouse. »
Ouverture de compte
Aftalion explique que les caisses d’épargne auraient ouvert des comptes aux femmes mariées à leur nom de jeune fille pour leur permettre ainsi de jouir de la liberté de disposer de leur argent : « Il est vrai que, par un moyen un peu détourné, la femme parvenait en fait à déposer à la caisse, et à retirer, sans le concours de son mari. Elle se faisait ouvrir un compte à son nom de jeune fille et aucune restriction ne limitait alors sa liberté. Les administrateurs des caisses ignorant ou feignant d’ignorer sa qualité d’épouse ne s’inquiétaient pas des pouvoirs du mari sur les deniers qui leur avaient été confiés. »
Aftalion ajoute : « Il semble que dans les caisses d’épargne on montrait assez de complaisance à admettre la véracité d’affirmations semblables de la part d’une femme mariée. Une pratique presque générale s’était constituée en ce sens. On rappellera souvent cette pratique dans les débats qui devaient avoir lieu au Parlement au sujet des propositions de loi sur les caisses d’épargne. »
Aftalion poursuit en donnant des exemples : « La faculté de dépôt, sans autorisation préalable existe, dira-t-on, mais elle existe d’une manière irrégulière[1] » ou encore : « Quand elles (les femmes) déposent à la caisse d’épargne, on ne refuse pas leurs dépôts, et quand elles les retirent, on ne leur refuse pas davantage leurs retraits… Le livret donne le nom de la femme, mais il n’indique pas particulièrement le nom du mari[2]. »
Il écrit par rapport au dernier exemple : « On peut voir dans cette dernière phrase comme un aveu de procédé employé par les caisses, pour déroger en faveur de l’épouse aux principes fondamentaux du Code civil. Mais on doit reconnaître que de cette manière, quelles que fussent les circonstances du fait qui souvent excusaient les habitudes des caisses d’épargne, on sortait entièrement de la légalité. Il pouvait paraître désirable par suite que la législation intervînt pour consacrer et surtout pour compléter la protection que la pratique accordait à l’épouse. »
Le vœu du grand économiste et juriste Aftalion ne sera exaucé par la législation française que quatre-vingt-quatre ans plus tard avec la reconnaissance par la loi de l’indépendance financière des femmes en 1965.
Source du texte : L’économie européenne en 100 citations, Cristina Peicuti, PUF, 2024
[1] Note de bas de page dans la citation « Discours de M. Tallon à l’Assemblée nationale, séance du 15 mai 1875 (Journal officiel du 16) ».
[2] Note de bas de page dans la citation « Discours de M. Robert de Massy au Sénat, séance du 28 mars 1881 (Journal officiel du 29) ».
Libre à elles !
1818 : la création de la Caisse d’Epargne constitue une innovation de rupture majeure. Elle ouvre à toutes et tous sans condition de ressources, les portes de l’épargne. Majeures et non mariées, les femmes ont ainsi toute liberté d’ouvrir un livret.
Le mariage reste néanmoins l’acte d’inscription sociale par excellence en ce début du XIXe siècle. On prend époux à 25 ans en moyenne, le célibat ne touche que 12 % des femmes. Une fois mariée, ces dernières perdent toute autonomie, le code Napoléon les plaçant sous l’entière autorité de leur mari, en matière d’argent notamment. Les portes de la Caisse d’Epargne ne s’ouvrent plus pour elles qu’accompagnées.
En 1881, une loi vient mettre à mal la toute puissance maritale inscrite dans le Code civil. Une révolution ! Elle autorise les épouses à librement utiliser leur livret. En pionnières, les Caisses d’Epargne permettent ainsi aux femmes d’accéder à une première émancipation financière, à laquelle elles n’auront pleinement droit dans l’ensemble du secteur bancaire qu’en 1965.
Hier, les femmes mariées ont dû batailler ferme pour conquérir leur indépendance ; aujourd’hui, les entrepreneures rencontrent encore bien des obstacles. Demain, comme hier et aujourd’hui, les Caisses d’Epargne continueront de les accompagner pour que jamais elles ne cessent d’oser.